L ’empereur Frédéric II Hohenstaufen (1194-1250) représente sans doute la personnalité la plus fascinante parmi les géants qui ont traversé le XIIIe siècle européen. À la croisée de l’histoire et du mythe, il demeure un personnage de légende dans la longue mémoire de l’Europe à l’image du souverain caché qui reviendra un jour restaurer l’ordre ancien aboli.
Sylvain Gouguenhein, auteur du magistral Aristote au Mont-Saint-Michel, lui a consacré un gros livre passionnant paru en septembre 2015 aux éditions Perrin Frédéric II, un empereur de légendes. Davantage qu’une biographie, l’historien a voulu présenter dans cet ouvrage une synthèse de sa pratique du pouvoir, une analyse des images qu’il a voulu laisser de son règne, les représentations et légendes tissées à son sujet par ses contemporains et la postérité.
Un empire immense « à la vérité ingouvernable »
Petit fils de l’empereur Frédéric Barberousse et du roi Roger II de Sicile, Frédéric-Roger Staufen (ou Hohenstaufen pour les historiens français) né au lendemain de la Noël 1194 semble promis aux plus hautes destinées. Pourtant, orphelin dès quatre ans, le jeune monarque grandira à la cour de Palerme comme un « agneau parmi les loups » dans une ambiance de guerre civile, sous la tutelle du pape et en proie aux intrigues des régents et des princes. En Allemagne son avenir semble également menacé, l’héritage impérial revenant aux Welf, ennemis héréditaires des Staufen. Sitôt sa majorité atteinte, le jeune orphelin sans armée mais aidé par la Fortune récupère le trône de Sicile puis reconquiert l’empire au terme d’une audacieuse chevauchée. Il ajoutera à sa titulature la couronne de roi de Jérusalem qu’il obtient par mariage en 1229. Cette puissance soudaine le place à vingt-six ans au sommet de la hiérarchie de princes d’Occident provoquant la méfiance puis l’hostilité des papes qui engageront une lutte à mort contre lui. Frédéric sera excommunié deux fois puis déposé. Après sa mort, l’anéantissement de la race des Staufen provoquera l’entrée du Reich germanique dans le « Grand Interrègne » (1250-1273).

Sylvain Gouguenheim, Frédéric II, un empereur de légende, éditions Perrin (septembre 2015)
À travers son livre, Sylvain Gouguenheim, historien spécialiste de la Germanie, offre un éclairage inédit sur le gouvernement de Frédéric en Allemagne, y consacrant deux importants chapitres. Le règne du Staufen en terre d’empire reste en effet largement méconnu et beaucoup considèrent que l’empereur aurait négligé l’Allemagne. L’historien démontre qu’il n’en fut rien. Malgré deux traditions politiques très différentes entre l’immense Reich germanique, monarchie élective morcelé par la féodalité, et la Sicile, royauté héréditaire dont le souverain est vassal du pape, Sylvain Gougenheim considère que « Frédéric n’a pas pour autant dissocié les différentes parties de son empire ». Pourtant, la centralisation appliquée à l’échelle du royaume de Sicile, considéré comme « la prunelle de ses yeux » par Frédéric, représentait un idéal inapplicable ailleurs. En Allemagne, Frédéric s’est inscrit dans la continuité de l’héritage politique des Saliens et des Staufen, il scella son pouvoir sur l’alliance avec les princes laïcs et ecclésiastiques, accentuant la féodalisation du Reich. Néanmoins les mêmes principes qu’en Sicile y furent appliqués : respect de l’autorité royale, rétablissement de la paix, maintien de la concorde. Frédéric promulgua un édit de paix perpétuelle (rédigé en allemand) en 1235 à la diète de Mayence rétablissant ordre et justice en échange de la confirmation des concessions faites aux princes territoriaux. Ce texte d’importance, pendant germanique du Liber augustalis, sera considéré comme une loi fondamentale du Reich. « S’il gouverna l’Allemagne à distance, il ne la transforma pas comme il le fit de la Sicile, nul ne l’aurait pu… » conclut Sylvain Gouguenheim.
En revanche, Frédéric organisa la Sicile, « pierre angulaire du royaume », comme un État moderne et centralisé, s’appuyant sur les héritages normand et byzantin. Véritable laboratoire politique pour le gouvernement de l’empire, il fit rédiger en 1231 le « Liber Augustalis », première codification du droit au niveau de l’État monarchique. Frédéric développa également un corps de fonctionnaires formés au sein du studium de Naples, première université laïque d’Occident, et s’intéressa fortement à l’activité économique.
En Allemagne comme en Sicile, l’objectif de Frédéric fut partout et toujours le même : exercer et défendre les droits royaux et impériaux, en usant avec souplesse des possibilités offertes par les situations locales. S’il est probable que Frédéric eut souhaité mieux asseoir sa puissance, il ne pût faire mieux devant l’immensité d’un empire s’étendant des rives de la Baltique à l’Adriatique et à la Terre Sainte, celui-ci était « à la vérité ingouvernable ».
Empereur divin et nouvel Auguste
Développant une conscience aiguë « du caractère sacré de son pouvoir et de sa personne », Frédéric estimait détenir son pouvoir de Dieu seul et non des papes, « si l’État réalisait la volonté de Dieu, la société et l’Église lui étaient subordonnées ». Cette conception l’entraînera dans une lutte d’une violence extrême contre Rome, s’inscrivant dans la lignée séculaire des conflits entre le sacerdoce et l’empire. Il fut davantage victime que responsable de cette guerre contre Rome qu’il n’avait pas souhaité et dont il n’avait certainement pas mesuré l’intensité ni la durée.
La haine que lui voua la papauté contribua à faire du Staufen « un personnage hors du commun (…) le démon dans lequel le mal universel s’incarnait ». En retour, Frédéric fit valoir son bon droit et sa proximité avec le Christ, accentuant le caractère transcendant de l’origine de son pouvoir. Tirant profit de l’héritage byzantin, il développa une sacralisation inouïe de sa personne et de sa fonction à travers ce que Sylvain Gouguenheim appelle les « hiérophanies impériales » qui frapperont l’imaginaire des contemporains. « Il fit bâtir avec constance des palais splendides et gigantesques, comme s’il devait être toujours victorieux, mais où il ne résida jamais. Il construisait des châteaux et des tours dans des villes et sur les montagnes comme s’il devait être assiégé chaque jour par des ennemis Il faisait tout cela pour montrer sa puissance, susciter l’admiration et la terreur, afin d’imprimer la mémoire de son nom dans l’esprit de chacun et que l’oubli ne puisse jamais l’abolir ».
Prince d’abord italien, Frédéric se considérait davantage comme l’héritier d’Auguste plutôt que de Charlemagne. Les augustales, monnaies d’or qu’il met en circulation, le représentent portant le manteau de pourpre impérial et coiffé d’une couronne de laurier, entouré de l’inscription IMP. ROM. CAESAR AUG. Par son allure, Sylvain Gouguenheim le rapproche des altières figures des cavaliers de Bamberg ou de Magdebourg, contemporaines du souverain, dont il considère qu’il est possible que leur sculpteur se soit inspiré de l’empereur comme modèle.
Prince architecte, Frédéric parsema son territoire d’impressionnantes forteresses, comme l’énigmatique Castel del Monte, en Sicile et en Italie. Il fit également bâtir un arc monumental à Capoue, aujourd’hui disparu, semblable aux monuments antiques, véritable porte du royaume et manifeste politique du régime frédéricien où il se fit représenter à la manière des empereurs romains. Cultivé, il s’entoura de nombreux penseurs, s’intéressa à la science, à la philosophie, aux arts et sera l’auteur d’un traité de fauconnerie qui fait encore autorité aujourd’hui.
Un souverain de son temps
Frédéric est souvent présenté comme un souverain éclairé, libre penseur, ami des juifs et des musulmans, régnant sur une Sicile multiculturelle… Le livre de Sylvain Gouguenheim remet l’Histoire à l’endroit sur ces thèses. S’il fut par certains aspects un précurseur, confiant à l’État des responsabilités nouvelles, dégagé de la tutelle ecclésiastique et limitant l’influence de l’Église à la diffusion de la foi, Frédéric est resté un prince de son temps. Durant son règne il comble les ordres monastiques, pourchasse les hérétiques, soutient fortement les teutoniques dont le Grand Maître de l’ordre, Hermann von Salza, fut l’un de ses plus proches et fidèles soutiens. S’il fut moins pieux que son contemporain Saint-Louis, rien n’indique qu’il rejetait la religion catholique.
Envers les penchants supposés du Staufen pour le monde arabo-musulman, Sylvain Gouguenheim rapporte qu’il est très peu probable que l’empereur ait parlé ou compris l’arabe, en dehors de quelques mots d’usage diplomatique. Il fait un sort également au prétendu harem que Frédéric aurait entretenu. Quant aux Arabes de Sicile, une fois liquidées les poches de résistance, les derniers musulmans furent déportés dans la colonie de Lucera. En 1240, il n’y avait ainsi quasiment plus de musulmans en Sicile, beaucoup s’étant enfuis en Afrique du Nord, d’autres s’étant convertis. « Il n’a en définitive toléré aucune insoumission de la part des musulmans vivant dans ses terres, a entretenu avec les dirigeants du monde islamique des relations diplomatiques non exemptes de courtoisie ou d’intérêt intellectuel mais n’a cessé de manifester son attachement à l’idée de croisade. (…) Frédéric II, tel qu’il fut en général interprété, exprime la frustration d’historiens face à une période dont la vision du monde était éloigné de la leur ».
« Vivit, non vivit »
Frédéric fut un mythe de son vivant, il reçut de ses contemporains les surnoms de Stupor Mundi (la « Stupeur du monde ») et de « prodigieux transformateur des choses », tandis que la papauté en faisait une bête vomie des enfers, contribuant involontairement à la fascination que Frédéric suscitait. Dernier empereur de la dynastie des Staufen, il deviendra une légende. Au jour de sa mort, son fils Manfred écrira à son frère le roi Conrad IV, une lettre qui commençait par ces mots : « Le soleil du monde s’est couché, qui brillait sur les peuples… ». Dans la conscience collective, avant que son mythe ne se confondit avec celui de son grand-père Frédéric Barberousse, il devint « l’Empereur endormi » dans les profondeurs d’une caverne du Kyffhäuser en Thuringe qui reviendra un jour restaurer l’Allemagne. En Sicile, un mythe analogue rapportait que Frédéric était celui qui dormait d’un sommeil magique dans le cratère de l’Etna.
Jusqu’au XXe siècle, le souvenir du Staufen hantera la mémoire des Européens. Nietzsche le célébra comme « le premier Européen qui convienne à mon goût ». Tout à la fois revendiqué et contesté, Frédéric sera ainsi réhabilité par les Lumières, encensé par les protestants, détesté par les catholiques, rejeté par les partisans de l’État-nation, adulé par les nostalgiques de l’empire.
Au lendemain de la première guerre mondiale, la révolution conservatrice allemande revendiquera la figure du Staufen. Ernst Kantorowicz, proche du poète Stefan George, lui consacra une monumentale et inégalée biographie sur laquelle Sylvain Gouguenheim revient d’ailleurs souvent. En 1924, de jeunes disciples du poète (parmi lesquels le frère de Claus von Stauffenberg) déposeront sur le tombeau de Frédéric à Palerme une couronne de feuillages de chêne portant l’inscription « à ses empereurs et héros, l’Allemagne secrète ».
Les grands bouleversements issus de la seconde guerre mondiale ont anéanti la mémoire allemande, emportant sa longue histoire. Sylvain Gougenheim rapporte ainsi que dans un sondage sur les personnalités les plus importantes de l’histoire allemande réalisé en 2003, Frédéric figurait en 94e position seulement, derrière un footballeur des années 1960… Aujourd’hui la figure de l’empereur Frédéric ne survit plus que dans la mémoire de quelques veilleurs ou érudits. Le livre de Sylvain Gouguenheim, très fouillé mais de lecture agréable même pour les non-spécialistes, contribuera à réveiller la mémoire de l’empereur endormi, à l’image de la sentence mystérieuse de la Sybille « vivit, non vivit » : « il vit, il ne vit pas », témoignant de l’éternelle résurgence du mythe.
Benoît Couëtoux du Tertre
À PROPOS DE
Sylvain Gouguenheim, Frédéric II, un empereur de légende, éditions Perrin (septembre 2015)
Crédit photo : Raffaele Esposito via Wikimedia (cc)







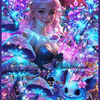














 Twitter
Twitter del.icio.us
del.icio.us Facebook
Facebook Digg
Digg Technorati
Technorati Yahoo!
Yahoo! Stumbleupon
Stumbleupon Google
Google Blogmarks
Blogmarks Ask
Ask Slashdot
Slashdot


















